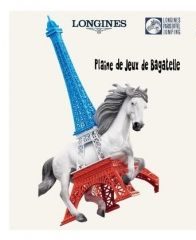Aux portes de l’Oural et de l’Asie, Moscou est, avec Londres et Paris, la seule métropole européenne à dépasser les dix millions d’habitants. La capitale russe partage d’ailleurs avec sa consoeur française une même concentration politique et culturelle en son cœur, également ceinte de deux ceintures de boulevards qui ne manquent pas de rappeler les délimitations dues aux fermiers généraux.
Scandale au Bolchoï
Mais si le Melomaner a franchi la rigueur des formalités consulaires, c’est avant tout pour explorer la diversité de la scène lyrique. Bien sûr le Bolchoï (qui signifie tout simplement « grand » en russe, autrement dit le « Bolchoï Theatr » c’est le « Grand-Théâtre », appellation culturellement contrôlée dont nous avons l’habitude en Europe occidentale) constitue une étape obligatoire. Ce temple de la grande tradition a subi une rénovation de fond en comble pendant plusieurs années avant sa réouverture il y a tout juste un an, au point d’y perdre son âme regretteront les détracteurs d’une opération aux dessous moins brillants que la nouvelle jeunesse de l’édifice mythique.
Pendant les travaux, l’institution a investi d’autres salles – entre autres le « Nouveau Bolchoï » voisin, élégant quoique moins majestueux, où se donne une production du Coq d’Or qui a suscité la polémique, entre autres de la part de l’église orthodoxe, laquelle a voulu faire interdire les représentations. Dès sa création en 1907, l’opéra de Rimski-Korsakov avait déjà subi les foudres de la censure à la censure. Inspirée par un conte satirique de Pouchkine, l’histoire n’est pas tendre avec le pouvoir : afin d’assurer pérennité et tranquillité à son règne, le tsar Dodon – rien que le ridicule du nom annonce la couleur – sollicite les conseils d’un astrologue. Celui-ci lui offre un coq d’or qui l’avertira de toute menace ; en échange, l’empereur devra lui donner ce qu’il souhaitera le moment voulu. De cette subtile parodie Faustienne du pacte avec Satan, on en a souvent retenu la féérie à destination des enfants – ce qui affadit incontestablement la charge corrosive de la fable.
Une relecture corrosive
Kirill Serebrennikov en a décidé autrement. Sur les corniches d’une salle d’apparat qui a tout l’air d’un musée encore plongée dans l’obscurité, des hommes en noir verrouillent la sécurité des lieux avant l’entrée du souverain, qui n’a d’autre désir que de dormir, rassuré par le gadget que lui a offert un excentrique en blouse blanche. La princesse qu’il ramène de ses batailles affiche le clinquant des nouveaux riches tandis que l’on jurerait reconnaître Poutine en l’un des généraux du tsar – mais le Kremlin se désintéresse ostensiblement de la musique. Plus encore qu’une critique ouverte, cette actualisation restitue toute l’ironie subversive de l’oeuvre – et les autorités religieuses ne goûtent guère l’ironie. Si l’on reconnaît en Alexander Teliga une pâte slave qui sied parfaitement au caractère débonnaire de l’empereur, c’est surtout la reine de Shemakhan chantée par Venera Gimadieva, la nouvelle Netrebko selon certains, déjà très demandée, qui retient l’attention de l’aéropage de directeurs d’opéras réunis dans la salle.
Bastions de la tradition
Avec Guerre et Paix de Prokofiev, le théâtre Stanislavski – géré par la municipalité de Moscou comme peut l’être le Châtelet à Paris – présente une adaptation d’un autre grand classique de la littérature russe, dans une mise en scène en revanche nettement traditionnelle. L’allure fantomatique du bal du premier acte distille une atmosphère onirique originale, quoiqu’en contradiction avec le faste de la valse, et contraste avec les choeurs massés sur le plateau dans la seconde partie, « Guerre » – près de quatre cents protagonistes. L’effet est garanti, même si une telle absence de distance avec la veine patriotique des ensembles, en partie exigée par Staline pour servir sa propagande au lendemain du second conflit mondial, serait difficilement exportable hors des frontières de la Russie – ce qui n’enlève rien pour autant à la solidité de l’interprétation, orchestrale comme vocale.
La chute de l’Union Soviétique a provoqué, telle un printemps de liberté une éclosion de nouvelles compagnies. Le Novaya Opera n’a de nouveau cependant que le label, tant les architectes semblent avoir ignoré l’évolution artistique depuis la révolution de 1917. Et ce n’est pas davantage le Prince Igor de Borodine corrigé par Alexander Titel qui dépoussiera la routine bruyante de la soirée. Décidément le spectacle ne passera pas le rideau de fer.
Crudité naturaliste à l’Helikon Opera
L’innovation est plutôt à chercher du côté de l’Helikon Opera, qui se trouve actuellement relégué dans un bâtiment administratif, en l’attente de son propre édifice, perpétuellement menacé par la corruption et le mépris du pouvoir. Metteur en scène reconnu à juste titre, Dmitri Bertman, le directeur artistique, propose en ces jours une Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovitch d’une incroyable force. Dans un décor noir qui évoque quelque lieu de perdition, Katerina, enfermée dans une cage – celle que lui impose son beau-père despotique et son mari aussi faible qu’ivrogne – attend désespérement le frisson amoureux et sexuel. Elle va le trouver avec Sergueï, un ouvrier de l’entreprise marchande des Ismaïlov. Si la servante se fait plus consentante que victime lors de son viol, la description de la relation sexuelle entre Katerina et son amant est d’une impressionnante crudité naturaliste, jusque dans la musique qui suggère la frénésie copulatoire et la débandade post-coïtum – les cuivres : un exemple de la causticité de Chostakovitch, servie par un orchestre d’une redoutable précision. Mais la découverte du cadavre de son époux légitime, dont ont voulu se débarrasser les adultères va les conduire en Sibérie, où l’héroïne sera délaissée par l’homme pour qui elle a tout abandonné, lequel lui préfèrera une autre femme. Katerina finira par se jeter avec sa rivale dans la Volga. Blonde et pulpeuse, Svetlana Sozdateleva incarne une Lady Macbeth à donner le frisson, et constitue l’un des pivots d’un spectacle que l’Helikon Opera, qui fait tous les deux ans une étape en France, pourrait bien présenter. En tous cas, ne manquez pas leur prochaine escale.
Mentionnons enfin le seul opéra au monde spécialement conçu pour les enfants par Natalie Sats en périphérie de la capitale, avatar d’un volontarisme admirable, même si la production des Trois Oranges de Prokofiev que nous y avons vue relève surtout du divertissement.













 [/popup]
[/popup]