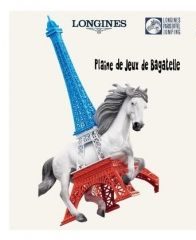Initialement confié à Patrice Chéreau, le Moses und Aaron, coproduit avec Madrid, par lequel Stéphane Lissner entendait inaugurer avec éclat son mandat à l’Opéra de Paris, est finalement revenu à un autre grand nom du théâtre contemporain, Romeo Castellucci. C’est dans cette mise en scène étrennée à Bastille l’automne dernier que l’opéra philosophique de Schönberg, adaptant un épisode de l’Exode, dans l’Ancien Testament, est joué pour la première fois au Teatro Real, dans une version, sans entracte, respectant l’inachèvement de l’oeuvre – le compositeur n’a pas mis en musique le troisième acte, resté à l’état de livret.
La pensée en images
S’ouvrant sur une bande magnétique descendant des cintres, image – non dénuée d’un soupçon d’ironie – de la parole divine comme enregistrée depuis l’éternité, et avec laquelle finit par s’emmêler Moïse, le spectacle affirme d’abord d’évidentes qualités plastiques qui n’exigent pas de s’échapper de la puissante dialectique littérale du texte. L’errance du prophète se trouve ainsi baignée dans une blancheur désertique où les formes s’effacent comme des mirages – parabole de la solitude et du sentiment d’impuissance du langage devant l’infini, que va bafouer la logorrhée de son frère Aaron, étanchant alors un peuple assoiffé d’idoles. Si, faisant le lien avec le taureau – vivant, et traité avec égard pour lui éviter toute souffrance, selon l’institution madrilène pour ne pas s’attirer les foudres des avocats de la cause animale – que l’on fait venir sur le plateau en guise de veau d’or, d’aucuns ont pu lire dans le bain de cire noire où plonge Aaron, et à sa suite la foule, la fascination éperdue de notre époque pour le pétrole, il s’agit d’abord de la souillure des mots et des images, contrastant avec la pureté immaculée de l’absolu de la révélation, que seul Moïse est parvenu à préserver à la fin des libations idolâtres. Incarnation d’une pensée musicale et philosophique en scénographie intelligible, le travail de Romeo Castellucci contribue à rendre accessible un ouvrage réputé difficile, pour la scène comme pour le public, sans que les artifices des mots projetés ou du robot aérospatial fassent verser l’ensemble dans la démonstration simplificatrice.
L’entrée de l’avant-garde au répertoire
Tournée vers l’assimilation de la tradition romantique, que l’iconoclaste et dodécaphonique Schoenberg entendait mener à son terme, la direction de Lothar Koenigs se révèle homogène à la conception visuelle. Le chef allemand témoigne d’une maîtrise évidente de la partition, qu’il a déjà dirigée. Plutôt que d’en surligner la modernité atonale, il s’attache à son architecture ordonnée autour de la forme à variations – à cette aune, les interludes ne manquent pas d’éloquence, et leur facture chamarrée dément la réputation austère de la musique de Schoenberg. Dominant la distribution vocale, le Moses gauche, âpre et fiévreux d’Albert Dohmen fait entendre un Sprechgesang habité. Aux limites parfois de son instrument, John Graham-Hall lui donne la réplique en Aaron, aux évidentes ressources de caractère où pourrait poindre, par exemple, le souvenir de la malice d’un Mime. Le reste des solistes ne démérite aucunement, jusqu’au quatuor de vierges et aux six voix célestes. Mais l’on retiendra surtout l’autre grand protagoniste du drame, le choeur, auquel revient l’une des parties les plus ardues du répertoire : l’on ne peut que saluer les forces de la maison, préparées admirablement par Andres Maspero. Schoenberg est désormais sorti du purgatoire de l’avant-garde.
Par Gilles Charlassier
Moses und Aaron, Teatro Real, Madrid, mai-juin 2016












 [/popup]
[/popup]