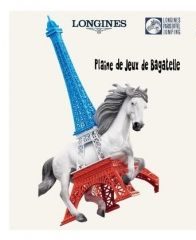« Faire du nouveau avec de l’ancien » : l’Opéra Comique fait sien cet adage pour sa rentrée, avec une nouvelle création à partir de Purcell. Après, en 2014, la reconstitution du service funèbre que Bach avait écrit pour le prince de Cöthen à partir de la Saint-Matthieu et de l’Ode funèbre BWV 198, Raphaël Pichon va encore plus loin dans la récréation baroque, et fait ses premiers pas dans la fosse de Favart avec un nouvel opéra à partir de la musique de Purcell et une pièce de Shakespeare.
Miranda reprend ainsi l’intrigue de La Tempête du point de vue de la fille de Prospero : elle a fait croire qu’elle s’était noyée pour se venger d’un père tyrannique qu’elle a dû suivre en exil, où elle a été violée par Caliban et mariée sans son consentement à Ferdinand. Dans la nef anglicane aseptisée où toute la mise en scène de Katie Mitchell se déroule, un office à la mémoire de l’enfant disparu est célébré, et le public reçoit en entrant dans la salle un feuillet résumant les funérailles qui se tiennent en l’Eglise Sainte Barbara à Dunwich, en Angleterre. Mais, coup de théâtre, Miranda surgit sous un voile de mariée perturber le recueillement et régler ses comptes.
L’émotion et la musique d’abord
En une heure trente, Miranda sait ménager des rebondissements saisissants, qui font déborder le théâtre de l’apparente sagesse du cadre de scène où est figé le décor. Plutôt que dans l’allure un peu réquisitoire du texte, c’est dans les demi-teintes de la réconciliation et de la stupéfaction finales que le travail de Cordelia Lynn distille le plus de cette humanité que la mise en scène ne cesse de contenir, et donne le plus de force à une parole féminine trop souvent étouffée, signe sans doute que, de manière assez rousseauiste, la réflexion à l’opéra surgit d’abord par l’émotion et la compassion.
Et pour toucher, la partition compilée par Raphaël Pichon s’y entend suprêmement. Le chef français dévoile une suprême et étonnante maîtrise des registres, imprimant des affects profanes sur des musiques sacrées et des textes religieux sur des pages qui ne le sont pas. A la tête de son ensemble Pygmalion, il modèle une admirable fluidité qui gomme tout ce qu’un tel exercice pourrait avoir de composite, et assume la véritable intelligence dramatique du spectacle, depuis un prologue rythmé par les cloches jusqu’à un épilogue sur des basses continues dénudées, comme une hébétude après la tempête des révélations, telle celle qui terrasse Prospero.
On reconnaît l’excellence des pupitres, généreux en couleurs et d’une précision expressive jamais en défaut, relayées par les solistes. Dans le rôle-titre, Kate Lindsey affirme une égale puissance dans les raucités du parler et la densité du chant. Katherine Watson dessine, en Anna, l’autre portrait de femme forte et fragile. Le solide Henry Waddington résume l’autorité sans grâce de Prospero, quand Allan Clayton offre un Ferdinand consistant. A Marc Mauillon incombe l’impossible mission pacificatrice du pasteur, tandis que le jeune Aksel Rykkvin livre l’innocence juvénile d’Anthony, le fils de Miranda. Le Choeur Pygmalion se répartit les interventions des personnages secondaires, et le spectacle reconstituant la jeunesse volée de l’héroïne. Original, Miranda confirme le pouvoir supérieur de la musique.
Par Gilles Charlassier
Miranda, Opéra Comique, septembre-octobre 2017












 [/popup]
[/popup]