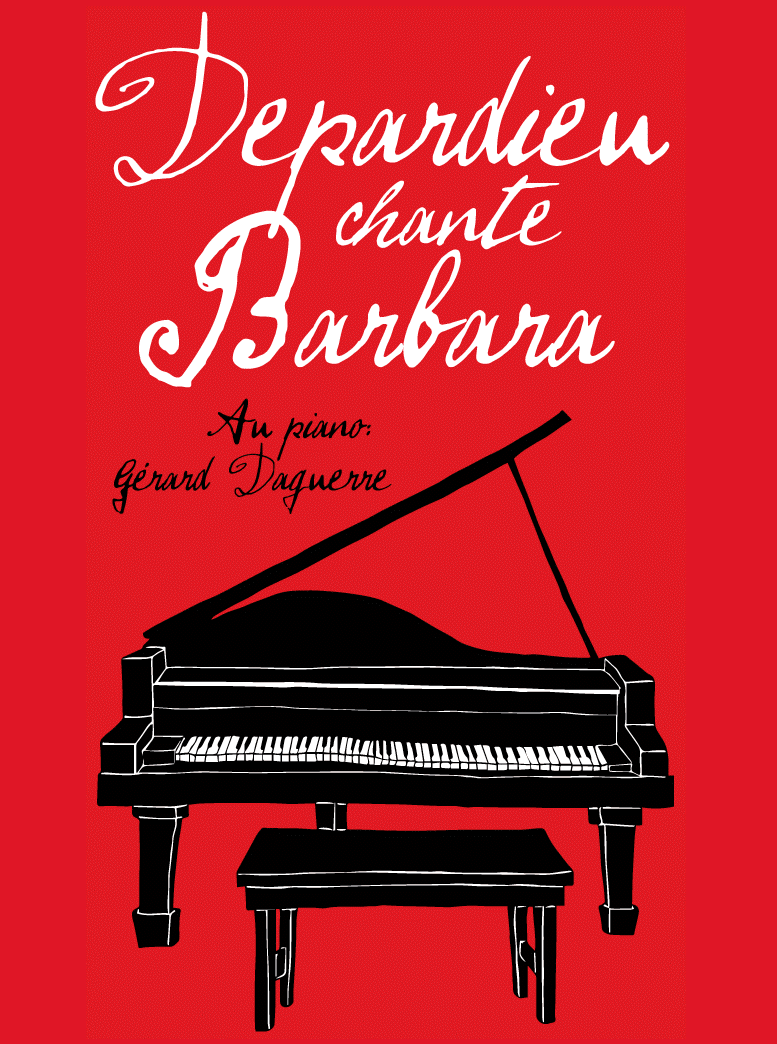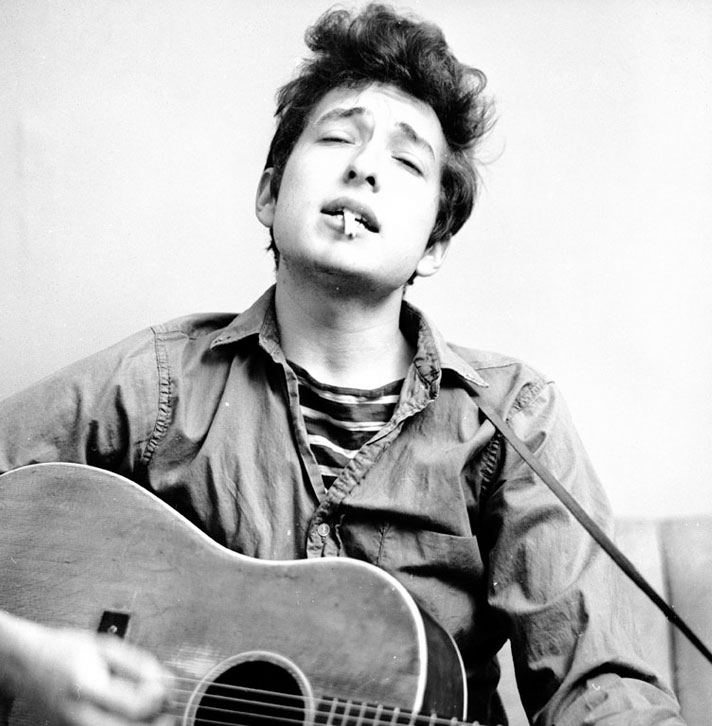Fondé en 1996 sous l’impulsion de Philippe Herreweghe, alors directeur artistique de ce que l’on appelait encore les Académies musicales de Saintes, le Jeune Orchestre de l’Abbaye, créé sous le nom de Jeune Orchestre Atlantique, réunit des jeunes musiciens, en fin d’études ou en début de carrière, au gré plusieurs résidences annuelles à l’Abbaye aux Dames de la cité saintongeaise, pour interpréter le répertoire classique et romantique sur instruments d’époque, dans la lignée de ce qui se faisait déjà pour le baroque. Au fil des années, ce sont désormais plusieurs générations qui ont pu bénéficier des conseils de grands chefs par ce dispositif unique à l’échelle européenne, en termes de transmission et d’accompagnement dans la professionnalisation. Le Festival de Saintes constitue évidemment une vitrine de choix, et l’inauguration, avec cette formation, de la première édition programmée par Ophélie Gaillard constitue un symbole fort reliant curiosité esthétique et partage des pratiques musicales.
Dirigé par Philippe Von Steinaecker, le concert dédié à Mendelssohn frère et sœur commence par un geste symbolique, en faveur de la reconnaissance des compositrices, avec l’Ouverture en do majeur de Fanny. Après une introduction lente aux aplats lumineux, la pièce déploie une fougue où les élans mozartiens ou rossiniens se conjuguent avec des harmonies que ne renierait pas Le songe d’une nuit d’été. L’authentique maîtrise des couleurs et des dynamiques orchestrales résonne avec un soupçon de prudence, le temps de rendre complémentaires les différents niveaux de chacun des pupitres qui, à l’exception des violoncelles, jouent debout. On retiendra les intentions initiées par la baguette, et l’engagement dans le choix de la pièce augurale de la soirée.
Un violon au lyrisme sincère et élégant
Des rangs des cordes se dégage alors le premier violon Aylen Pritchin, qui interprète la partie soliste d’une des plus célèbres pages du répertoire, le Concerto n°2 en mi mineur opus 64 de Felix Mendelssohn. L’émulsion des premières mesures de l’entrée du concertiste donne le ton d’une lecture empreinte de sensibilité où l’orchestre se fait davantage partenaire que confrontation dialectique. La fluidité du discours dans l’Allegro molto évolue vers un lyrisme délicat, qui fait respirer la souplesse de la ligne mélodique d’un Andante aux allures de romance sans paroles, d’une sincérité aussi élégante qu’évidente. La légèreté aérée de l’archet, qui n’hésite pas faire frémir l’intonation pour accompagner l’intelligence expressive, livre une autre facette de sa personnalité dans les acrobaties du finale. Ce feu d’artifice de virtuosité n’en reste écrase cependant pas pour autant le tamis orchestral qui le porte discrètement, dans cette conclusion réunissant soliste et tutti en une même jubilation de rythmes et de couleurs, à laquelle un bis Bach donne un postule d’une sereine intensité.
Après l’entracte, la Symphonie n°3 en la mineur opus 56, surnommée Écossaise confirme une énergie juvénile qui gagne en précision au fil de la partition. La mise en place progressive dans l’Andante con moto aboutit à un Allegro un poco agitato où les cuivres naturels sont parfois exposés. Sous la houlette du chef allemand, l’éclosion des couleurs instrumentales d’époque prend néanmoins rapidement l’ascendant sur l’oreille, et restitue toute la saveur du Vivace non troppo. La construction de l’homogénéité sonore trouve un aboutissement dans les nuances de l’Adagio, avant l’impétuosité vibrante d’un Allegro vivacissimo que couronne une péroraison Allegro maestoso assai où l’ensemble des musiciens communient avec un plaisir communicatif.
Le lendemain matin, dans le cadre plus intime de l’Auditorium de l’Abbaye, Maxim Emelyanychev rejoint Aylen Pritchin dans des duos pour violon et piano du plus célèbre triangle musical et amical du Romantisme allemand. Deuxième des trois Sonates que Brahms composa pour cet effectif, l’opus 100 en la majeur dévoile des demi-teintes magnifiées par la complicité chambriste des deux solistes, au fil de trois mouvements nourris d’échos et de citations. Les Trois Romances opus 22 de Clara Schumann, dédiées au violoniste Joseph Joachim qui créa le Concerto pour violon de Brahms, dévoilent une subtilité dans le dialogue instrumental avec lequel contrastent les tourments de la Sonate n°2 opus 121 de son époux Robert, dont la première fut également assurée par Joseph Joachim. Avec un bis Brahms et la Méditation de Thaïs de Massenet se referme une parenthèse au cœur du raffinement d’un salon du XIXème siècle, avec un enthousiasme au diapason de la fraîcheur de la lutherie historique. A Saintes, le patrimoine renaît comme s’il était d’aujourd’hui.
Par Gilles Charlassier
Festival de Saintes, juillet 2025, concerts du 12 et 13 juillet 2025.