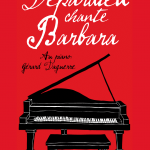A deux cents kilomètres de La Roque d’Anthéron, le Festival de Menton s’est imposé, depuis l’arrivée de Paul-Emmanuel Thomas, comme une étape incontournable du piano pendant l’été, en misant sur quelques grandes sensibilités artistiques d’aujourd’hui, et de demain, plutôt qu’un foisonnement plus ou moins exhaustif. Conçus avec le soutien de la célèbre firme japonaise, les deux concerts Jeunes Talents Yamaha au Palais de l’Europe présentent six des candidats parmi les plus prometteurs du prochain Concours Chopin de Varsovie, dans un programme entièrement consacré au maître franco-polonais.
A deux cents kilomètres de La Roque d’Anthéron, le Festival de Menton s’est imposé, depuis l’arrivée de Paul-Emmanuel Thomas, comme une étape incontournable du piano pendant l’été, en misant sur quelques grandes sensibilités artistiques d’aujourd’hui, et de demain, plutôt qu’un foisonnement plus ou moins exhaustif. Conçus avec le soutien de la célèbre firme japonaise, les deux concerts Jeunes Talents Yamaha au Palais de l’Europe présentent six des candidats parmi les plus prometteurs du prochain Concours Chopin de Varsovie, dans un programme entièrement consacré au maître franco-polonais.
Kwanwook Lee ouvre le second de ces deux rendez-vous avec Sonate n°2 en si bémol mineur op. 35. Le soliste sud-coréen s’appuie sur le contraste entre la tension dramatique des accords auguraux du premier mouvement et la section centrale plus chantante. Ce même équilibre se retrouve dans le Scherzo, avant une Marche funèbre tournée vers une intensité expressive à la sincérité cependant assez académique. Joué comme un précipité des thèmes de la partition réduits à l’état de traces, le perpetuum mobile finale trouve ici une appréciable lisibilité.
Andrej Wlercinski, un nom à suivre
Dès la Ballade n°4 en fa mineur op. 52, Andrej Wlercinski se distingue par son instinct du style et une indéniable maturité musicale. La maîtrise du rubato confère à la fluidité mélodique une souplesse et une élégance de salon romantique, dénuée cependant de toute afféterie. Dans ce mélange entre allant et retenue, ce sens du phrasé, jusque dans ses menues inflexions, nourrit la compréhension profonde de ce célèbre chef-d’œuvre. Une légère nonchalance peut parfois colorer le Scherzo n°4 en mi majeur op.54 qui lui est contemporain. Mais la volubilité soyeuse du toucher magnifie les modulations lumineuses de la pièce, qui forme dans le programme miniature du jeune soliste un diptyque complémentaire et un condensé de l’art de Chopin dont il possède déjà une science remarquable.
L’entrée d’Eva Strejcova est marquée par une assurance moindre. Épaulée par Michal Szymanowski, lauréat de nombreux concours, qui a préparé les candidats invités à Menton et assure la partie orchestrale transcrite pour un deuxième piano du Concerto n°2 en fa mineur op.21, la Tchèque noue un dialogue sans heurt avec son tuteur. Le lyrisme du Maestoso, plus évident dans le second thème, se confirme dans un Larghetto non dénué de chaleur. Le finale fusionne les interventions du soliste et du tutti dans une coda pleine de vitalité.
Une intégrale Ravel magistrale par Bertrand Chamayou
Le lendemain, Bertrand Chamayou reprend l’intégrale de musique pour piano solo de Ravel, un compositeur qui accompagne le soliste français depuis le début de sa carrière. Devant la blancheur crépusculaire baignant le Parvis de la Basilique Saint-Michel, la soirée s’ouvre sur un Prélude livré non sans une relative – et provisoire – prudence. Cette brève page fonctionne comme une antichambre au premier grand cycle du concert, Miroirs, qui esquisse les grands lignes d’une compréhension devenue instinctive de la pensée musicale ravélienne où fusionnent le timbre et le rythme. Apprivoisant progressivement l’acoustique, sinon les paramètres météorologiques d’un plein air balnéaire presque calibré pour le recueil, les textures arpégées des Noctuelles colorent naturellement les vols de ces papillons nocturnes. La palette évocatrice se déploie dans les Oiseaux tristes, avec une langueur parfois émaillée de coups d’ailes de tempo esquissant les errances dans le ciel. Une barque sur l’océan prolonge cette dimension picturale qui prend avec Alborada del gracioso une tonalité hispanisante et bouffonne par son staccato de guitare. C’est cette même recherche dans les effets rythmiques du piano qui restitue les balancements de La vallée des clochers, transformant les paysages à la Liszt en irisations pointillistes.
Après un Menuet en guise d’intermède, le parcours dans les premières années du corpus ravélien se poursuit avec la Sonatine, qui compte également un Mouvement de menuet archaïsant au milieu d’une introduction notée Mesuré et un finale Animé. Bertrand Chamayou fait ressortir, avec une parfaite assimilation des indications de la partition, combien la modulation des climats successifs repose sur les variations de pulsation, dans une toile sonore liquide et rayonnante. Une troisième miniature scande cette première partie de soirée, A la manière de Borodine, qui réinvente les tournures mélodiques et harmoniques du maître russe. Le monument qu’est Gaspard de la nuit confirme une science naturelle du caractère, dans les contrastes et les complémentarités entre les épisodes du triptyque inspiré par Alyosius Bertrand. Depuis les frémissements aquatiques d’Ondine jusqu’à la féerie dramatique de Scarbo, en passant par les hallucinations du Gibet, les expérimentations virtuoses sont autant de ressources expressives, et la présente lecture souligne l’indivisibilité de la poésie et des ressources techniques de clavier – un trait distinctif de Ravel, et de sa modernité derrière une apparence moins révolutionnaire que d’autres musiciens de son époque.
L’alchimie du timbre et du rythme
Au retour de l’entracte qui a laissé la nuit envelopper l’arrière-plan panoramique du parvis, les Valses nobles et sentimentales illustrent à merveille cette alchimie entre l’ancien et l’original. Les huit numéros s’enchaînent comme un kaléidoscope des différents visages de la valse, de la contenance aristocratique à l’encanaillement du piano-bar, en passant par les pudeurs de l’approche amoureuse. L’axiome selon lequel le rythme ravélien est sa poétique même est ici porté à sa quintessence, mais explicitée sans aucun didactisme. La maîtrise et la sincérité du jeu suffisent.
Ravel a non seulement pratiqué le pastiche, mais il en a fait miroiter toutes les diverses facettes, entre le souvenir des thèmes humoristiques de l’auteur d’España dans A la manière de Chabrier et la construction à la mode du classicisme viennois dans le Menuet sur le nom de Haydn. Après les bouffonneries de la Sérénade grotesque, écho d’Alborada del gracioso, et les éblouissements irrésistibles de Jeux d’eau, le Menuet antique illustre encore cette fascination pour les formes anciennes qui trouve son apogée dans la Pavane pour une infante défunte, d’une dignité sous laquelle affleure délicatement l’émotion, et plus encore dans le Tombeau de Couperin. La suite se fait un véritable feu d’artifice où l’intelligence musicale s’épanouit dans une sensualité idiomatique de Ravel. Le Prélude prépare une Fugue jouant habilement avec les codes du genre, avant une Forlane amidonnée avec gourmandise et un Rigaudon non moins savoureux. Un Menuet offre une courte pause avant l’ivresse d’une Toccata à la pyrotechnie jamais vaine, qui referme une soirée qui peut d’ores et déjà s’inscrire dans la légende du Festival de Menton.
Par Gilles Charlassier
Festival de Menton, du 22 juillet au 8 août 2025, concerts des 30 et 31 juillet 2025