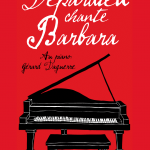Née en 1941 et formée par les grands maîtres de la danse moderne américaine, comme Merce Cunningham, Twyla Tharp vient de recevoir, lors de la 19ème Biennale de danse de Venise, placée sous le thème de « faiseurs de mythes », le Lion d’Or pour l’ensemble de la carrière d’une pionnière dans la synthèse entre techniques classiques et contemporaines.
Cet éclectisme qui l’inscrit dans la lignée légendaire d’un Jerome Robbins s’affirme dans une pièce de 1998, Diabelli, sur les célèbres variations que Beethoven a composées pour le piano. Dans l’écrin du Teatro Malibran, le jeu combinatoire de la musique, avec le clavier de Vladimir Rumyantsev en fosse, est transposé dans un catalogue de pas, de solos et d’ensembles qui rappelle la gymnastique poétique des Études de Lander, l’humour en plus. les postures et les portés ne manquent pas de faire quelques clins d’œil à la vitalité souriante du chorégraphe de West Side Story. Comme dans The Concert, la parodie s’invite dans ce récital de notes et de gestes, au diapason de la partition elle-même, qui mêle les registres avec une intarissable faconde. Au fil d’une heure de miniatures dansées, qui s’enchaînent et se chevauchent au rythme des permutations du thème de la valse de Diabelli, cet exercice de style qui n’est peut-être pas sans quelques longueurs, mais n’ennuie jamais.
Twyla Tharp, la rencontre des pointes et de Broadway
Nouvelle création de 2025, donnée pour la première fois en Europe lors de la Biennale de danse de Venise, Slacktide renouvelle un langage éclectique dans une forme de spectacle total minimaliste. La partition Aguas da Amazonia de Glass déploie ses boucles hypnotiques reconnaissables, dont les couleurs évocatrices sont accentuées dans l’arrangement pour flûte et quatuor percussif réalisé par Third Coast Percussion. Sur cette trame sonore, les solistes démontrent le même enthousiasme que dans la première pièce de la soirée, sous les éclairages calibrés par Justin Townsend, dans des effets d’optique qui rappellent parfois Vasarely. Au fil de ses déclinaisons lumineuses aux allures de verres teintés, Slacktide fusionne en une énergie commune les corps et le cadre visuel. La danse pure se fait alors transdisciplinaire. Avec Twyla Tharp, la quintessence chorégraphique est une fête pour l’oeil et l’oreille.
Dans cette même esthétique où la répétition rime avec invention, le Biennale College Dancers, académie qui réunit des étudiants pendant deux mois et demi, reprend la chorégraphie de Sasha Waltz sur In C au moment de la pandémie de covid. Développée avec les interprètes, elle fait se succéder les interactions au gré des 53 cellules de la partition de Riley, confiée aux pupitres du Syntax Ensemble. Le mélange de spontanéité improvisatrice et d’écoute attentive du mouvant flot rythmique, façonnant figures et rencontres comme autant de saynètes minimalistes, entre élans ludique et jeux mathématiques, tout cela fait de la page de Riley un point de départ pour un partage sans cesse nouveau, sur scène et avec le public du Teatro alle Tese de l’Arsenal.
Carolina Bianchi et la « Fraternité »
En attribuant le Lion d’argent à Carolina Bianchi, la Biennale de danse et son directeur artistique Wayne McGregor mettent en avant une dimension performative, au-delà du genre chorégraphique au sens strict – dans une belle complémentarité avec un Lion d’or qui consacre, en Twyla Tharp, une carrière tournée vers la quintessence du mouvement. Après La Mariée et Bonne nuit Cendrillon, diptyque créé au Festival d’Avignon en 2023, le deuxième volet de la trilogie Cadela Força que l’artiste brésilienne présente avec son collectif Cara de Cavalo, poursuit l’interrogation de la place de la femme dans l’histoire de l’art, l’exploration du trauma lié aux violences sexuelles, et surtout la possibilité d’une réconciliation.
The Brotherhood – La Fraternité – se présente comme une conférence à partir de cinq cents pages de réflexions et témoignages que Carolina Bianchi a écrite à la suite du viol qu’elle a subi, avec un travail sur l’ambivalence de la vidéo. Depuis une déambulation vénitienne sur écran, elle entre sur le plateau par une porte latérale du Teatro Piccolo de l’Arsenale, selon un procédé certes éprouvé. Ce trouble entre présence et virtuel se retrouve peu après dans le doublage par une voix masculine, effaçant le clivage entre les genres que la première intervention de Carolina Bianchi va remettre en cause autour de la différence de légitimation des artistes femmes, qui ne seraient prises au sérieux que si elles s’appuient sur leur propre vie.
Car si The Brotherhood développe avec une exhaustivité passablement bavarde la toxicité du pouvoir viril, la « fraternité » des hommes face aux accusations d’abus sexuels, la pièce est aussi une tentative de s’en affranchir. C’est d’ailleurs ce qui en fait le mouvement dramaturgique. Comme les pulsations musicales, simples et hypnotiques, de Miguel Caldas, la puissance réconciliatrice de la vie, cette autre « fraternité » peut être plus forte. Sous sa vigueur militante, Carolina Bianchi affirme une ironie corrosive, qui détourne certains tropismes du body art et ses variantes, prenant le corps comme objet performatif. Au-delà des gestes et des mots, elle fait émerger, au fil de The Brotherhood, l’art comme une tentative pour relier l’humanité. Sa singularité n’est pas dans ses intentions, mais un processus immersif, avec ses tâtonnements et ses longueurs, qui fait naviguer l’expression physique par-delà les frontières entre les genres et les disciplines.
Mentionnons encore, dans ce champ artistique, la proposition d’Antony Hamilton Chunky Move United au Teatro alle Tese, qui fait naître la danse dans un univers de science-fiction, ainsi que l’exposition photographique d’Indigo Lewin, un fonds d’archives de la Biennale qui a aussi été publié dans un livre d’art.
Par Gilles Charlassier
Biennale de danse de Venise, du 17 juillet au 2 août 2025, spectacles des 18 et 20 juillet 2025